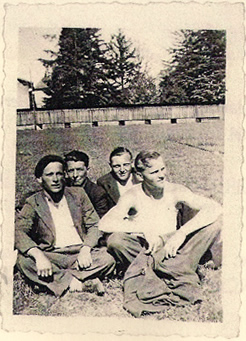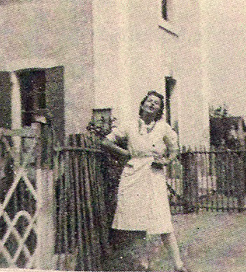| |
|
|
|
|
 |
|
|
| |
|
La
guerre m'a chassé de ma Lorraine natale.
Et j'ai marché, longtemps, en Dauphiné et ailleurs.
A la rencontre de l'olivier.
L'arbre nourricier millénaire, dont les ramures symbolisent
la paix.

|
|
| |
|
|
|
|
|
Avant – propos
80 ans …
 C'est
un âge respectable et redoutable pour celui qui l'atteint. C'est
un âge respectable et redoutable pour celui qui l'atteint.
 C'est l'âge où
les « neurones » prennent congé, plus
ou moins vite. C'est l'âge où
les « neurones » prennent congé, plus
ou moins vite.
 C'est aussi le début
du 5ème âge, celui où tout un chacun doit préparer
sa sortie de scène. C'est aussi le début
du 5ème âge, celui où tout un chacun doit préparer
sa sortie de scène.
 Il convient
tout à fait pour jeter un regard sur ce qui s'est passé
dans votre vie, heurs et malheurs confondus. Il convient
tout à fait pour jeter un regard sur ce qui s'est passé
dans votre vie, heurs et malheurs confondus.
 Ce récit
n'est pas dicté par une vaine gloriole. Ce serait tout à
fait mal venu. Ce récit
n'est pas dicté par une vaine gloriole. Ce serait tout à
fait mal venu.
Non, cela s'est tout simplement passé comme cela ; sans plus.
Nous ne sommes pas « poussière ».
 Mon espoir
c'est que chacun en tirera la conviction qu'il ne faut « jamais
baisser les bras », comme l'a si joliment chanté
Pierre Bachelet. Mon espoir
c'est que chacun en tirera la conviction qu'il ne faut « jamais
baisser les bras », comme l'a si joliment chanté
Pierre Bachelet.
*** |
|
|
|
|
|
|
|
Que dire de mon enfance ?
 Nous habitions
Waldwisse (Moselle) où je suis né, dans une mesure
louée au boucher du coin. Mon père était ouvrier
boulanger à la coopérative de Wendel, le maître
des Forges qui possédait tout, ou presque, dans cette région. Nous habitions
Waldwisse (Moselle) où je suis né, dans une mesure
louée au boucher du coin. Mon père était ouvrier
boulanger à la coopérative de Wendel, le maître
des Forges qui possédait tout, ou presque, dans cette région.
 Son lieu
de travail étant éloigné de trente kilomètres
environ de Waldwisse, il était absent la plupart du temps
et ne rentrait qu'à l'occasion de congés ou de weekend
prolongés. C'est donc ma mère qui assurait le quotidien
avec un budget vraiment serré. Quatre bouches à nourrir
: mon frère aîné, Charles Edouard (Edi dans
la vie courante), ma sœur Lucie, Jeanne, et moi-même,
le plus jeune. Son lieu
de travail étant éloigné de trente kilomètres
environ de Waldwisse, il était absent la plupart du temps
et ne rentrait qu'à l'occasion de congés ou de weekend
prolongés. C'est donc ma mère qui assurait le quotidien
avec un budget vraiment serré. Quatre bouches à nourrir
: mon frère aîné, Charles Edouard (Edi dans
la vie courante), ma sœur Lucie, Jeanne, et moi-même,
le plus jeune.
Je me souviens très bien qu'elle allait piocher les betteraves
chez un paysan voisin pour le repas de midi et quelques denrées
comestibles qu'elle ramenait pour nous nourrir.
 En 1933 nous avons pu nous
rapprocher du lieu de travail de mon père, et nous installer
à Marspich (village aujourd'hui intégré à
la commune de Hayange). La situation est devenue un peu meilleure
pour la simple raison que mon père pouvait rentrer après
son travail et ne payait plus de pension. En 1933 nous avons pu nous
rapprocher du lieu de travail de mon père, et nous installer
à Marspich (village aujourd'hui intégré à
la commune de Hayange). La situation est devenue un peu meilleure
pour la simple raison que mon père pouvait rentrer après
son travail et ne payait plus de pension.
 C'est en 1934 ou 1935 que
Lucie, ma sœur aînée, est tombée malade.
Elle avait fait des études primaires brillantes et réussi
son certificat d'études primaires, (bilingue français-allemand)
avec mention « très bien », première
du canton de Sierck. Nous étions tous très fiers d'elle. C'est en 1934 ou 1935 que
Lucie, ma sœur aînée, est tombée malade.
Elle avait fait des études primaires brillantes et réussi
son certificat d'études primaires, (bilingue français-allemand)
avec mention « très bien », première
du canton de Sierck. Nous étions tous très fiers d'elle.
 Son prix d'excellence était
un livre de collection intitulé « Océola
guerrier séminole ». Je cite ce titre de mémoire
car je n'ai jamais pu le retrouver. Il a bercé mon adolescence
et il ne faut pas chercher ailleurs les raisons pour lesquelles
j'aime tant utiliser les mots Tribu et Grand Sachem. Son prix d'excellence était
un livre de collection intitulé « Océola
guerrier séminole ». Je cite ce titre de mémoire
car je n'ai jamais pu le retrouver. Il a bercé mon adolescence
et il ne faut pas chercher ailleurs les raisons pour lesquelles
j'aime tant utiliser les mots Tribu et Grand Sachem.
 Lucie
avait été placée en maison bourgeoise car il
ne pouvait pas être question de ne pas travailler. Elle est
tombée malade chez ses employeurs, tuberculose. On ne savait
pas encore soigner cette maladie dans les années 30 et elle
est morte en 1937. Lucie
avait été placée en maison bourgeoise car il
ne pouvait pas être question de ne pas travailler. Elle est
tombée malade chez ses employeurs, tuberculose. On ne savait
pas encore soigner cette maladie dans les années 30 et elle
est morte en 1937.
 J'étais à
côté de ma mère lorsqu'elle rendu le dernier
soupir, j'avais 14 ans. J'étais à
côté de ma mère lorsqu'elle rendu le dernier
soupir, j'avais 14 ans.
 J'ai
quitté le giron familial à mon tour quelques semaines
après ma scolarité. Mes parents, par manque de ressources
sans doute, n'ont pu me permettre de faire des études secondaires
comme le souhaitait mon instituteur, Monsieur Henry. J'ai
quitté le giron familial à mon tour quelques semaines
après ma scolarité. Mes parents, par manque de ressources
sans doute, n'ont pu me permettre de faire des études secondaires
comme le souhaitait mon instituteur, Monsieur Henry.
 Je serai donc boulanger,
comme mon père et suis entré en apprentissage chez
Monsieur Jung Ferdinand, à Seremange (Moselle). Je serai donc boulanger,
comme mon père et suis entré en apprentissage chez
Monsieur Jung Ferdinand, à Seremange (Moselle).
 Après un an d'essai
et deux années de formation pratique, j'ai subi avec succès
les épreuves du C.A.P en 1940, j'avais 17 ans. Après un an d'essai
et deux années de formation pratique, j'ai subi avec succès
les épreuves du C.A.P en 1940, j'avais 17 ans.
Le document qui m'a été délivré était
rédigé dans la langue de Goethe, car nous étions
devenus citoyens Allemands, de facto (nous y reviendrons). Je n'ai
pu supporter cela, d'autant moins qu'il était « orné »
d'un sceau au centre duquel s'étalait une énorme Croix
Gammée.
L'horreur
 J'ai déchiré
ce document en 1945. Dommage... aujourd'hui ce serait une « archive »
inhabituelle. Cela n'enlève rien au fait que j'ai obtenu
de C.A.P d'ouvrier boulanger ce qui normalement devait sceller mon
destin sur le plan professionnel. J'ai déchiré
ce document en 1945. Dommage... aujourd'hui ce serait une « archive »
inhabituelle. Cela n'enlève rien au fait que j'ai obtenu
de C.A.P d'ouvrier boulanger ce qui normalement devait sceller mon
destin sur le plan professionnel.
 La guerre 1939-1945 est
passée par là et en a décidé autrement. La guerre 1939-1945 est
passée par là et en a décidé autrement.
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Mes grands-parents maternels |
| |
Anna-Maria et Anton Philipp |
|
|
 J'étais
encore en apprentissage en 1939 lorsque la guerre et la mobilisation
générale furent déclarées. J'étais
encore en apprentissage en 1939 lorsque la guerre et la mobilisation
générale furent déclarées.
C'est à Ottange, en juin 1940, que j'ai subi le baptême
des armes, vu pour la première fois un soldat tué
d'une balle en plein front. L'Allemagne venait de lancer son offensive
sur la Moselle en passant par le Luxembourg ce qui nous a jetés
sur les routes, sous les « piqués »,
oh combien bruyants, des Stukas allemands.
 Je n'avais pas loin pour
aller rejoindre le domicile familial à Marspich et, tout
naturellement, la boulangerie Jling à Seremange pour y travailler
à nouveau. Je n'avais pas loin pour
aller rejoindre le domicile familial à Marspich et, tout
naturellement, la boulangerie Jling à Seremange pour y travailler
à nouveau.
 Il faut croire que mon
apprentissage n'était pas terminé car pendant quelques
semaines l'absence de courant électrique nous a obligées
à réapprendre le pétrissage à la main,
sans levure et sans sel. Le résultat n'était pas des
plus brillant mais pourtant, dès l'aube, une queue se formait
pour acheter ce pain que personne aujourd'hui ne voudrait sur sa
table. La faim rôdait par là. Elle commande et fait
accepter bien des choses. Il faut croire que mon
apprentissage n'était pas terminé car pendant quelques
semaines l'absence de courant électrique nous a obligées
à réapprendre le pétrissage à la main,
sans levure et sans sel. Le résultat n'était pas des
plus brillant mais pourtant, dès l'aube, une queue se formait
pour acheter ce pain que personne aujourd'hui ne voudrait sur sa
table. La faim rôdait par là. Elle commande et fait
accepter bien des choses.
 La fée électricité
revenue j'ai été embauché à Blidange
chez Monsieur Welsh, où j'ai appris les rigueurs de l'occupation
allemande. Les rues, les noms des commerces, les noms même
des communes « germanisés » me devenaient
étrangers. Le port du béret, décrété
coiffure Française, très mal vu. On m'en a volé
trois et je dois avouer qu'ils l'ont été par des jeunes
Mosellans entrés dans les Jeunesses Hitlériennes.
La honte. La fée électricité
revenue j'ai été embauché à Blidange
chez Monsieur Welsh, où j'ai appris les rigueurs de l'occupation
allemande. Les rues, les noms des commerces, les noms même
des communes « germanisés » me devenaient
étrangers. Le port du béret, décrété
coiffure Française, très mal vu. On m'en a volé
trois et je dois avouer qu'ils l'ont été par des jeunes
Mosellans entrés dans les Jeunesses Hitlériennes.
La honte.
Plusieurs fois chargé de porter à l'administration
les tickets de pain dûment collés sur de grandes feuilles,
je me suis vu mettre à la porte parce qu'en entrant je disais
« bonjour » et non « Heil Hitler ».
J'avais un peu plus de 17 ans.
 Blessé
à la main j'ai dû quitter cet emploi et me suis vu
affecter d'office à la boulangerie Heil de Basse Yutz. Ce
nom pour un collaborateur était vraiment prédestiné.
Une nuit, il voulait sans doute sonder mon état d'esprit,
une vive discussion nous a opposés et je suis parti, sur
le champ. Non je n'étais pas pour les allemands. Blessé
à la main j'ai dû quitter cet emploi et me suis vu
affecter d'office à la boulangerie Heil de Basse Yutz. Ce
nom pour un collaborateur était vraiment prédestiné.
Une nuit, il voulait sans doute sonder mon état d'esprit,
une vive discussion nous a opposés et je suis parti, sur
le champ. Non je n'étais pas pour les allemands.
 Dénoncé par
Heil à l'organisme chargé de l'organisation du travail,
j'ai été placé chez un boulanger de nationalité
Allemande qui s'était vu attribuer la boulangerie d'un français
expulsé d'Uckange. Inutile de dire qu'il était vigilant
et que j'évitais tout commentaire superflu. Dénoncé par
Heil à l'organisme chargé de l'organisation du travail,
j'ai été placé chez un boulanger de nationalité
Allemande qui s'était vu attribuer la boulangerie d'un français
expulsé d'Uckange. Inutile de dire qu'il était vigilant
et que j'évitais tout commentaire superflu.
 Mes 18 ans approchant,
j'ai reçu ma convocation pour une visite d'aptitude à
« l'arbeitzdienst », antichambre de la Wehrmacht.
J'ai subi cette visite..... déclaré apte. Diable il
fallait aviser. Non, je ne servirai pas en Allemagne. Mes 18 ans approchant,
j'ai reçu ma convocation pour une visite d'aptitude à
« l'arbeitzdienst », antichambre de la Wehrmacht.
J'ai subi cette visite..... déclaré apte. Diable il
fallait aviser. Non, je ne servirai pas en Allemagne.
 Mes parents, que j'avais
informés de mes intentions, m'ont donné leur accord
mais mon père, en guise de viatique, me commanda (littéralement)
« de ne rien faire dont il puisse avoir à rougir
ensuite ». Mes parents, que j'avais
informés de mes intentions, m'ont donné leur accord
mais mon père, en guise de viatique, me commanda (littéralement)
« de ne rien faire dont il puisse avoir à rougir
ensuite ».
Message reçu.
 Certes
nous savions que les Nazis ne seraient pas contents, mais de là
à imaginer la répression qu'ils exerceraient, il y
avait un pas que nous n'avons pas franchi. Pourtant eux l'ont fait. Certes
nous savions que les Nazis ne seraient pas contents, mais de là
à imaginer la répression qu'ils exerceraient, il y
avait un pas que nous n'avons pas franchi. Pourtant eux l'ont fait.
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
L'intention de partir était claire mais comment
procéder ?
 J'avais conservé
de bonnes relations avec mon patron boulanger de Budange nommé
Welsh. Il a pu me conseiller un passage par Moyeuvre-Grande en Moselle
« annexée » et ménager une rencontre
avec un premier passeur sur une place de ce village devenu frontière
avec la Meurthe et Moselle « occupée »
mais restée Française. J'avais conservé
de bonnes relations avec mon patron boulanger de Budange nommé
Welsh. Il a pu me conseiller un passage par Moyeuvre-Grande en Moselle
« annexée » et ménager une rencontre
avec un premier passeur sur une place de ce village devenu frontière
avec la Meurthe et Moselle « occupée »
mais restée Française.
 Muni d'un petit bagage
et d'un mini viatique me voilà parti. C'était le 20
janvier 1942. Mon passeur de Moyeuvre était au rendez-vous
et il m'a guidé par des chemins à travers champs et
forêts jusqu'à proximité de la « frontière
et indiqué la direction de Joeuf. Muni d'un petit bagage
et d'un mini viatique me voilà parti. C'était le 20
janvier 1942. Mon passeur de Moyeuvre était au rendez-vous
et il m'a guidé par des chemins à travers champs et
forêts jusqu'à proximité de la « frontière
et indiqué la direction de Joeuf.
Première étape, l'hôpital de
Joeuf.
 Que dire de ce premier
bon, sinon que je me suis mis à courir dans la direction
indiquée, tant et si bien que j'ai heurté un grillage
et que dans l'élan je me suis retrouvé de l'autre
côté, me relevant en Meurthe et Moselle après
une bûche magistrale. Que dire de ce premier
bon, sinon que je me suis mis à courir dans la direction
indiquée, tant et si bien que j'ai heurté un grillage
et que dans l'élan je me suis retrouvé de l'autre
côté, me relevant en Meurthe et Moselle après
une bûche magistrale.
Des passants m'ont indiqué la direction de l'hôpital
où je suis arrivé en fin d'après-midi.
 Une sœur, sœur
Élisabeth sans doute, (directrice de l'hôpital Sœur
Eustache), me conduisit à la chaufferie où je passai
la nuit, nourri et couvert. Je ne suis pas resté seul bien
longtemps. Six prisonniers de guerre en cours d'évasion et
deux camarades Lorrains fuyant comme moi m'ont rejoint. Une sœur, sœur
Élisabeth sans doute, (directrice de l'hôpital Sœur
Eustache), me conduisit à la chaufferie où je passai
la nuit, nourri et couvert. Je ne suis pas resté seul bien
longtemps. Six prisonniers de guerre en cours d'évasion et
deux camarades Lorrains fuyant comme moi m'ont rejoint.
 Le lendemain, nous avons
quitté l'hôpital de Joeuf guidés jusqu'en gare
d'Homecourt par trois dames que nous suivions, trois par trois,
à quinze vingt mètres de distance, en les identifiant
par leur chapeau de couleur différente (vert pour ce qui
me concerne). Il s'agit sans doute, je l'ai appris en 1996, de Primot
Lucie, Milandr Yolande et Cremel Marie-Thérèse. Le lendemain, nous avons
quitté l'hôpital de Joeuf guidés jusqu'en gare
d'Homecourt par trois dames que nous suivions, trois par trois,
à quinze vingt mètres de distance, en les identifiant
par leur chapeau de couleur différente (vert pour ce qui
me concerne). Il s'agit sans doute, je l'ai appris en 1996, de Primot
Lucie, Milandr Yolande et Cremel Marie-Thérèse.
 A Homecourt
on nous remit à chacun un billet pour Jarny (Meurthe et Moselle),
nous n'avons pas revu nos trois guides. A Homecourt
on nous remit à chacun un billet pour Jarny (Meurthe et Moselle),
nous n'avons pas revu nos trois guides.
Dans le wagon, une main se pose sur mon épaule et j'entends
: « Alors on se fait la belle !?! ». Je vous
laisse deviner ma stupeur et mon effroi. L'homme qui me parlait
portait la casquette des Chemins de Fer et veillait sur nous. Il
était décontracté lui, beaucoup plus que nous.
 La nuit était tombée
à notre arrivée à Jarny et nous avons été
conduits dans une maison pour une courte nuit. Là encore
après visite sur place en 1996, je pense qu'il s'agit de
M.Bonino ou de Mgnemmi. La nuit était tombée
à notre arrivée à Jarny et nous avons été
conduits dans une maison pour une courte nuit. Là encore
après visite sur place en 1996, je pense qu'il s'agit de
M.Bonino ou de Mgnemmi.
 Vers quatre heures, réveil,
en route vers la gare (importante) de triage où un wagon
à bestiaux vide nous a accueilli. Formidables cheminots.
Dès lors c'est d'eux que dépendait notre sort. Il
était entre de bonnes mains. Vers quatre heures, réveil,
en route vers la gare (importante) de triage où un wagon
à bestiaux vide nous a accueilli. Formidables cheminots.
Dès lors c'est d'eux que dépendait notre sort. Il
était entre de bonnes mains.
Le train s'est mis en mouvement, en avant, en arrière, pour
la formation du convoi.
 C'est pendant les heures
qui ont suivi que j'ai pris conscience du froid. Il était
intense dans ce wagon dont la porte était fermée,
certes, mais où l'air circulait quasi librement. Qu'à
cela ne tienne, une ronde effrénée nous apportait
le réconfort et nous aidait à faire face, avec il
faut bien le dire, de temps à autre, une rasade d'eau de
vie qu'un ami charitable avait donnée à l'un des prisonniers. C'est pendant les heures
qui ont suivi que j'ai pris conscience du froid. Il était
intense dans ce wagon dont la porte était fermée,
certes, mais où l'air circulait quasi librement. Qu'à
cela ne tienne, une ronde effrénée nous apportait
le réconfort et nous aidait à faire face, avec il
faut bien le dire, de temps à autre, une rasade d'eau de
vie qu'un ami charitable avait donnée à l'un des prisonniers.
 Par contre à chaque
arrêt, immobilité absolue. Les prisonniers de guerre
étaient particulièrement tendus. Certains en étaient
à la troisième tentative d'évasion et étaient
décidés à défendre leur liberté.
L'un d'entre-eux ouvrait à chaque arrêt un impressionnant
couteau et se plaçait à proximité de la porte. Par contre à chaque
arrêt, immobilité absolue. Les prisonniers de guerre
étaient particulièrement tendus. Certains en étaient
à la troisième tentative d'évasion et étaient
décidés à défendre leur liberté.
L'un d'entre-eux ouvrait à chaque arrêt un impressionnant
couteau et se plaçait à proximité de la porte.
Que se serait-il passé en cas d'intrusion
?
 Dans la nuit du 22 au 23
janvier, arrêt dans une autre gare de triage? Des cheminots,
nos anges gardiens, nous ont conduits dans un autre wagon, chargé
de sacs de soude (?) avant le passage de la ligne de démarcation
séparant zone occupée de la zone libre. Nous nous
sommes entassés sur ces sacs, à proximité des
ouvertures d'aération. Peu avant la fermeture du wagon une
famille juive (le père, la mère et un jeune enfant)
ont pris place avec nous. Dans la nuit du 22 au 23
janvier, arrêt dans une autre gare de triage? Des cheminots,
nos anges gardiens, nous ont conduits dans un autre wagon, chargé
de sacs de soude (?) avant le passage de la ligne de démarcation
séparant zone occupée de la zone libre. Nous nous
sommes entassés sur ces sacs, à proximité des
ouvertures d'aération. Peu avant la fermeture du wagon une
famille juive (le père, la mère et un jeune enfant)
ont pris place avec nous.
 Porte fermée, plombée,
nous voilà partis pour ce contrôle dont on nous avait
dit qu'il était long et méticuleux. Porte fermée, plombée,
nous voilà partis pour ce contrôle dont on nous avait
dit qu'il était long et méticuleux.
Interdiction formelle de faire le moindre bruit, de tousser - ce
qui n'était pas facile avec les poussières de soude
– de bouger pendant toute la durée de l'arrêt.
 Cela a duré environ
une demi-heure et nous avons pu entendre les voix teutonnes, le
bruit des portes de wagon ouvertes et refermées, notre verrou
vérifié puis abandonnée fermé à
la vue du plombage. Cela a duré environ
une demi-heure et nous avons pu entendre les voix teutonnes, le
bruit des portes de wagon ouvertes et refermées, notre verrou
vérifié puis abandonnée fermé à
la vue du plombage.
Enfin le train est reparti.
 La maman juive qui avait
bâillonné son bébé avec une serviette
s'est alors occupée de le faire réagir. Il était
inerte au début puis, divine surprise, s'est mis à
pleurer. La maman juive qui avait
bâillonné son bébé avec une serviette
s'est alors occupée de le faire réagir. Il était
inerte au début puis, divine surprise, s'est mis à
pleurer.
 Le 23 en fin de journée,
nous sommes arrivés à Lyon Vaise. Les cheminots avaient
livré leurs « colis ». Notre groupe
s'est séparé. Les prisonniers d'un côté,
la famille juive je ne sais où, et nous, les Mosellans désormais
libres, au Centre la Scaronne où nous nous sommes endormis
après enregistrement de notre arrivée. Le 23 en fin de journée,
nous sommes arrivés à Lyon Vaise. Les cheminots avaient
livré leurs « colis ». Notre groupe
s'est séparé. Les prisonniers d'un côté,
la famille juive je ne sais où, et nous, les Mosellans désormais
libres, au Centre la Scaronne où nous nous sommes endormis
après enregistrement de notre arrivée.
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
Arrivé
à Lyon, que faire ?
 Sans
famille ni amis qui auraient pu m'accueillir ou me conseiller, j'étais
plutôt désemparé, heureux d'avoir réussi
mais un peu perdu. Sans
famille ni amis qui auraient pu m'accueillir ou me conseiller, j'étais
plutôt désemparé, heureux d'avoir réussi
mais un peu perdu.
 Il faut se souvenir que
mes parents étaient pauvres et que l'argent que m'avait remis
ma mère avant mon départ était forcément
d'un montant peu élevé. Il faut se souvenir que
mes parents étaient pauvres et que l'argent que m'avait remis
ma mère avant mon départ était forcément
d'un montant peu élevé.
 Rien de mieux à
faire que de contracter un engagement volontaire de trois ans dans
un régiment caserné au Fort Lamothe. Rien de mieux à
faire que de contracter un engagement volontaire de trois ans dans
un régiment caserné au Fort Lamothe.
 Le caporal
Schutz Charles, originaire de Montigny Les Metz m'a amené
à la caserne le 24 janvier 1942 dans la matinée. Le caporal
Schutz Charles, originaire de Montigny Les Metz m'a amené
à la caserne le 24 janvier 1942 dans la matinée.
Le soir, sans pouvoir avaler quoi que ce soit, je me suis endormi
jusqu'au lendemain soir.
 C'est le médecin
Major qui m'a réveillé car mes nouveaux camarades
étaient inquiets. C'est le médecin
Major qui m'a réveillé car mes nouveaux camarades
étaient inquiets.
« Laissez le dormir »
 Le lendemain
matin, j'étais d'attaque mais affamé. Le lendemain
matin, j'étais d'attaque mais affamé.
Je me suis engagé au 153ème Régiment d'Infanterie
Alpine pour trois ans. Le drapeau Français flottait au mat...
de la cour d'honneur.
 Nous
étions nombreux Alsaciens ou Mosellans dans cette unité,
à tel point que des livrets militaires sous une identité
d'emprunt avaient été établis par nos chefs
pour nous soustraire aux contrôles effectués par les
allemands en application des accords d'Armistice. Nous
étions nombreux Alsaciens ou Mosellans dans cette unité,
à tel point que des livrets militaires sous une identité
d'emprunt avaient été établis par nos chefs
pour nous soustraire aux contrôles effectués par les
allemands en application des accords d'Armistice.
 Début
novembre 1942, la zone « libre » était
occupée par les allemands et l'Armée d'Armistice dissoute. Début
novembre 1942, la zone « libre » était
occupée par les allemands et l'Armée d'Armistice dissoute.
Une nouvelle fois, il m'a fallu fuir et chercher un refuge.
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Mes parents, Angèle et
Frédéric Staeger |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 |
| |
Retour de déportation... |
|
|
 J'avais
fait, en septembre 1942, la connaissance de Georges Nivollet dit
« pain cuit », boulanger à Marcilloles
(Isère). Il m'avait offert de le remplacer au fournil pendant
qu'il allait à la chasse... sa passion. C'était inespéré,
pour occuper mes trente jours de permission parce-qu'en ces temps
de restrictions alimentaires, surtout à Lyon, nous avions
faim en permanence. J'avais
fait, en septembre 1942, la connaissance de Georges Nivollet dit
« pain cuit », boulanger à Marcilloles
(Isère). Il m'avait offert de le remplacer au fournil pendant
qu'il allait à la chasse... sa passion. C'était inespéré,
pour occuper mes trente jours de permission parce-qu'en ces temps
de restrictions alimentaires, surtout à Lyon, nous avions
faim en permanence.
C'était le seul point de chute possible et je m'y suis rendu
transporté par des hommes secourables qui sont restés
inconnus.
 « Pain
cuit » ne pouvait m'employer en permanence (pas assez
de travail). Il m'a trouvé un emploi de domestique de ferme,
où je suis resté un an (1943). « Pain
cuit » ne pouvait m'employer en permanence (pas assez
de travail). Il m'a trouvé un emploi de domestique de ferme,
où je suis resté un an (1943).
Et puis en octobre de cette année là, la chance a
bien voulu me sourire, le « mitron » devenu
« caporal » a été accueilli
par la « Gendarmerie Nationale » sous sa véritable
identité.
 Elle
a fait de moi, au terme de trente ans de carrière, un Capitaine
admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1973,
puis Chef d'Escadron Honoraire au moment de sa radiation des Cadres
de l'Armée par limite d'âge. Elle
a fait de moi, au terme de trente ans de carrière, un Capitaine
admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1973,
puis Chef d'Escadron Honoraire au moment de sa radiation des Cadres
de l'Armée par limite d'âge.
 Au début
l'aventure avait été plaisante, en quelque sorte,
malgré quelques frayeurs et émotions. Au début
l'aventure avait été plaisante, en quelque sorte,
malgré quelques frayeurs et émotions.
Mais la sanction allait tomber, inexorable.
 En mai
1942, mes parents, mon frère et mes deux sœurs, Jeanne
et Germaine âgée à l'époque de neuf ans
à peine, ont été appréhendés,
chargés dans un wagon de marchandises et déportés
en raison de mon évasion, déclarés « indignes
d'habiter dans un département frontalier ». En mai
1942, mes parents, mon frère et mes deux sœurs, Jeanne
et Germaine âgée à l'époque de neuf ans
à peine, ont été appréhendés,
chargés dans un wagon de marchandises et déportés
en raison de mon évasion, déclarés « indignes
d'habiter dans un département frontalier ».
 Mes remords
et mon chagrin lorsque la nouvelle m'est parvenue en juillet 1942,
ont été intenses comme on peut l'imaginer. Mes remords
et mon chagrin lorsque la nouvelle m'est parvenue en juillet 1942,
ont été intenses comme on peut l'imaginer.
 J'étais
prêt à repartir en Moselle pour les faire rentrer chez
eux... J'étais
prêt à repartir en Moselle pour les faire rentrer chez
eux...
 Les amis
qui m'entouraient et le Capitaine qui commandait ma Compagnie ont
eu beaucoup de mal à me faire comprendre que ce n'était
pas la bonne solution. Les amis
qui m'entouraient et le Capitaine qui commandait ma Compagnie ont
eu beaucoup de mal à me faire comprendre que ce n'était
pas la bonne solution.
Je suis resté.
 Pendant
trois années ma famille a été trimballée
d'un camp de travail à l'autre, Linz (Autriche), Erfurt puis
Cassel (Allemagne). Pendant
trois années ma famille a été trimballée
d'un camp de travail à l'autre, Linz (Autriche), Erfurt puis
Cassel (Allemagne).
 Certes, ils n'ont pas été
exterminés, mais l'obligation au travail, la vie au camp
dans des baraquements de 45 personnes, étaient les contraintes
quotidiennes de même que les bombardements alliés,
en 1945 sur Cassel. Certes, ils n'ont pas été
exterminés, mais l'obligation au travail, la vie au camp
dans des baraquements de 45 personnes, étaient les contraintes
quotidiennes de même que les bombardements alliés,
en 1945 sur Cassel.
 Ils sont
rentrés en 1945, malades mais vivants et j'ai pu les serrer
dans mes bras, le cauchemar terminé en septembre 1945. Ils sont
rentrés en 1945, malades mais vivants et j'ai pu les serrer
dans mes bras, le cauchemar terminé en septembre 1945.
*** |
|
|
|
|
|
| |
Quatres amis en 1943/1944 |
| |
|
| |
Léon Moine, Gilbert Gatelet (expulsé
d'Alsace), Jean Pflieger (expulsé de Moselle), Moi
(20 ans) |
|
|
 J'ai appris
en 1996, le prix payé par les passeurs de Joeuf qui ont permis
mon évasion. J'ai appris
en 1996, le prix payé par les passeurs de Joeuf qui ont permis
mon évasion.
 L'excellent livre de l'abbé
Pierre François relate comment le réseau de passeurs
de Joeuf a été démantelé. L'excellent livre de l'abbé
Pierre François relate comment le réseau de passeurs
de Joeuf a été démantelé.
Un traitre, nommé Selzer, originaire de Thionville, partisan
des nazis, les a trahis après s'être « évadé »
pour identifier les passeurs.
Lamentable trahison. La justice est passée et l'a condamné
à mort. Sentence exécutée.
 Il n'empêche que
vingt six personnes ont été arrêtées
par sa faute, huit sont mortes dans les camps d'extermination ou
en cours de transferts. Il n'empêche que
vingt six personnes ont été arrêtées
par sa faute, huit sont mortes dans les camps d'extermination ou
en cours de transferts.
 Saurons-nous rendre à
ces hommes et à ces femmes, si courageux dans leurs actes,
l'hommage qui leur est dû. Saurons-nous rendre à
ces hommes et à ces femmes, si courageux dans leurs actes,
l'hommage qui leur est dû.
 Sans doute pas assez. Sans doute pas assez.
En tous cas ils ont livré le bon combat, il faut le rappeler.
 Je ne
connaissais le nom d'aucune des personnes dont j'ai parlé
dans ce récit. La discrétion était de règle,
même entre compagnons d'évasion. Je ne
connaissais le nom d'aucune des personnes dont j'ai parlé
dans ce récit. La discrétion était de règle,
même entre compagnons d'évasion.
Un regret lancinant, celui de ne pas avoir fait le pèlerinage
de Joeuf à Jarny à temps pour rencontrer les survivants,
rentrés chez eux après la défaite des envahisseurs
nazis. J'aurais pu leur dire merci de vive voix, regarder leurs
visages de braves français, ayant agi sans rien réclamer
en échange, pas un centime, pour l'amour des frères
humains que nous ne devrions jamais cesser d'être.
 Adolf
Hitler et ses sbires voulaient faire de nous des « Reichsgenossen »,
traduisez « Compagnons du Reilch Allemand ».
C'était sans compter sur notre refus et sur les Passeurs
de l'Orne. Adolf
Hitler et ses sbires voulaient faire de nous des « Reichsgenossen »,
traduisez « Compagnons du Reilch Allemand ».
C'était sans compter sur notre refus et sur les Passeurs
de l'Orne.
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
 Au Fort
Lamothe, soldat engagé, j'ai appris discipline et efforts
physiques sur fond de restrictions alimentaires mais je me suis
fixé un but : « Me préparer au combat qui,
un jour ou l'autre, nous opposerait aux forces armées du
Reich, pour les chasser de chez nous ». Au Fort
Lamothe, soldat engagé, j'ai appris discipline et efforts
physiques sur fond de restrictions alimentaires mais je me suis
fixé un but : « Me préparer au combat qui,
un jour ou l'autre, nous opposerait aux forces armées du
Reich, pour les chasser de chez nous ».
Mon premier grade après un peloton « sérieux
et musclé » :
Caporal, le 24 novembre 1942
153 – RIA – Fort Lamothe – Lyon
Trois jours avant la dissolution de l'armée
d'armistice.
 Retour
à Marcilloles, chez Nivollet d'abord, Clément, agriculteur,
puis Poncet, laitier, qui m'ont permis de survivre, sans salaire
mais avec gîte et couvert. Retour
à Marcilloles, chez Nivollet d'abord, Clément, agriculteur,
puis Poncet, laitier, qui m'ont permis de survivre, sans salaire
mais avec gîte et couvert.
C'est ainsi que je suis arrivé dans ce village, dont les
habitants ont accueilli sans problème l'étranger que
j'étais alors.
Toujours recherché par les Allemands, omniprésents
en zone libre, même dans les campagnes, ma vie pendant toute
l'année 1943 a été discrète.
 Un jour
d'ailleurs, j'ai eu la peur de ma vie. Un jour
d'ailleurs, j'ai eu la peur de ma vie.
Ce jour là, le Maire du village, Monsieur Mogniat, avait
un problème avec un détachement « schleuh ».
Il n'a rien trouvé de mieux que de m'appeler pour servir
d'interprète.
Imaginez la scène !
Heureusement, le sous-officier commandant le détachement
n'a rien deviné... et n'a pas réagi. Ouf !
*** |
|
|
|
|
|
|
|
 J'étais
immergé dans cette communauté et travaillais, à
la manière d'un Lorrain, c'est à dire de toutes mes
forces et du mieux que je pouvais. J'étais
immergé dans cette communauté et travaillais, à
la manière d'un Lorrain, c'est à dire de toutes mes
forces et du mieux que je pouvais.
Et puis, un jour de l'année 1943, j'ai remarqué une
jeune fille qui, ma foi, ne me tournait pas le dos.
Elle s'appelait Henriette Girerd-Chanel et travaillait dans une
usine de moulinage à Marcilloles..
Son père, Joseph, était cheminot en retraite après
un grave accident du travail. Sa mère, Valentine, garde barrière
à côté de la gare, ils étaient logés
dans la « maisonnette » par la SNCF.
 Vous raconter les ruses
de sioux que j'ai déployé pour approcher cette jeune
fille et sa famille est une entreprise trop ardue. Vous raconter les ruses
de sioux que j'ai déployé pour approcher cette jeune
fille et sa famille est une entreprise trop ardue.
 A cette
époque, il fallait avoir une « situation »
avant d'être admis à courtiser. Or l'emploi de domestique
de ferme ou garçon laitier n'en était pas. A cette
époque, il fallait avoir une « situation »
avant d'être admis à courtiser. Or l'emploi de domestique
de ferme ou garçon laitier n'en était pas.
Une fois admis dans la Gendarmerie, j'ai franchi le pas et posé
ma candidature au mariage, bien entendu après ma titularisation
de Gendarme.
 Je suis
sorti de cette visite, en « nage » mais avec
la permission d'engager une correspondance pendant mon stage. Je suis
sorti de cette visite, en « nage » mais avec
la permission d'engager une correspondance pendant mon stage.
Chouette non !
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Les parents d'Henriette, Joseph et Valentine
Girerd Chanel |
| |
Henriette (debout) et Andrée, sa
soeur |
|
|
 Henriette avait une soeur,
Andrée, plus âgée, que la maladie avait frappée
très cruellement. Henriette avait une soeur,
Andrée, plus âgée, que la maladie avait frappée
très cruellement.
Une polyarthrite déformante avait bloqué la quasi
totalité des articulations de son corps et elle souffrait
le martyr à chaque mouvement.
Tout effort lui était impossible et il fallait l'aider en
permanence y compris pour les actes essentiels de la vie (se vêtir
par exemple).
 Son mari, Georges Nivollet,
l'avait épousée en connaissance de cause et assumait
cette situation. Son mari, Georges Nivollet,
l'avait épousée en connaissance de cause et assumait
cette situation.
Le corps d'Andrée était dépendant mais pas
son esprit. Elle avait une volonté de fer et réussissait
même à coudre malgré ses doigts déformés.
 J'étais stupéfait
de voir Georges "filer" comme on disait alors et encaisser
les reproches quand il se montrait maladroit. J'étais stupéfait
de voir Georges "filer" comme on disait alors et encaisser
les reproches quand il se montrait maladroit.
Quelle leçon !!!
Ainsi "fonctionnait" la famille dans laquelle j'allais
entrer.
Je n'ai jamais eu à le regretter. |
|
|
|
|
|
| |
|
(...) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|